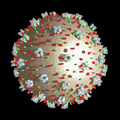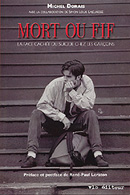Homophobie et Santé
"La seule évocation des unions de même sexe provoque chez certains une anxiété qui n'est autre que l'angoisse de mort et se manifeste sous la forme d'une hostilité vis-à-vis des homosexuels, dès lors jugés coupables du risque imaginaire de disparition de l'espèce, or les homosexuels existent depuis toujours et cela n'a pas empêché la surpopulation" Daniel Borillo
Dernière modification le 22 avril 07
35 articles, 10 illustrations, 7 liens doc, 9 liens sites
_______________________________________
Sursuicidalité des homosexuels
![]()
Discriminations envers les séropositifs
Les chiffres de la discrimination envers les séropositifs
Argumentaire pour le don du sang par les homosexuels de SOS-homophobie
Colloque association adhéos 17 sur la suicidalité
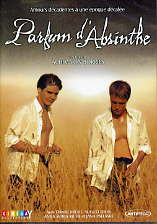
Le suicide révèle la souffrance particulière des jeunes homosexuels
Un livre sur le suicide des jeunes homos
Site des alcooliques anonymes homosexuels
Masseurs enchantés
Fiche juridique : Don du sang
Discriminations : Aides dénonce l'absurdité du refoulement des immigrés séropositifs
Aides a dénoncé mercredi, dans un communiqué, "l'absurdité" de refouler des immigrés séropositifs, après les propos tenus en ce sens la semaine dernière par le Premier ministre conservateur australien, John Howard.
Aides dénonce "l'absurdité de ces mesures qui ne font même pas la différence entre une maladie contagieuse et une maladie transmissible", et dénonce "un nouvel exemple d'atteinte à la liberté de circulation".
L'association estime que "la seule voie de sortie de cette situation alarmante est l'adoption d'un traité international par lequel les pays reconnaissent qu'aucun critère lié à la sérologie d'une personne n'est utilisé pour refuser un visa d'entrée sur le territoire".
"Malgré la sollicitation de la France en décembre 2006, l'Union européenne n'a toujours pas été capable de se prononcer en faveur de la libre circulation des séropositifs", déplore Aides.
Ainsi, des participants à une Conférence internationale sur le VIH/sida n'avaient pu se rendre à Barcelone en 2002 ou à Toronto en 2006, raconte Aides.
e-llico Mis en ligne le 19/04/07
Zap : Act Up drape de noir l'entrée du ministère de la Santé contre Sarkozy
L'association Act Up a drapé de noir l'entrée du ministère de la Santé et collé des affiches sur les baies vitrées du rez-de-chaussée, mercredi, pour dénoncer les propositions en matière de santé de Nicolas Sarkozy.
Une quinzaine de militants ont participé à cette action, qui a duré un quart d'heure en milieu de matinée.
Après le départ d'Act Up, les vigiles du ministère sont sortis pour arracher les affiches à tête de mort noire, les mêmes que celle de la campagne d'affichage de rue lancée il y a quinze jours par l'association de lutte contre le sida.
Pour Act Up, "si le candidat de l'UMP est élu président de la République , le ministère de la santé ne sera plus qu'une coquille vide. L'association dénonce les mesures UMP en matière de santé comme "dangereuses" : l'instauration d'une franchise annuelle (portant sur les médicaments, les examens biologiques, les consultations et l'hospitalisation), la "dérégulation du système hospitalier public", "l'expulsion de malades étrangers dans des pays où ils mourront faute de traitement" et "l'absence d'engagement pour le financement de la lutte contre le sida dans le monde".
e-llico Mis en ligne le 19/04/07Projet de maison de la santé LGBT, (et non exclusivement gay) .
par Olivier Jablonsky et Georges Sideris de The Warning : il s'agit de monter une structure abordant l'ensemble des problématiques liées à la santé LGBT, à la fois santé physique et santé mentale. Tel qu'ils l'imaginent, il pourrait y avoir un/des médecin-s, psychologue-s, assistante-s sociale-s, mais ce devrait aussi être un espace de discussion et de dialogue avec, par exemple, un fort encadrement associatif ou militant.
De fait, on pourra y aborder les vrais problèmes des vrais gens, le suicide, qui, relève de la santé mentale. Mais aussi du VIH, des gonocoques, des chlamydiae et des papillomavirus, des interactions des antirétroviraux et des traitements hormonaux, des effets secondaires des ARV sur le corps des femmes, sur leur sexualité et leur libido, etc.
L'un des intérêts d'une structure de ce type réside dans la possibilité pour des personnes LGBT d'aborder avec des spécialistes (médecins et non-médecins) les problèmes auxquels elles et ils sont confronté-e-s; par exemple, pour un jeune gay souffrant de telle ou telle IST mais ne sachant pas la diagnostiquer et n'osant pas en parler à son médecin de famille, de venir s'y renseigner, y consulter éventuellement, ou plus simplement avoir des gens auxquels il puisse s'adresser.
De fait, il vaudra mieux, pour le jeune gay en question, être francilien plutôt que lillois si le centre est à Paris; les copains et copines de province monteront pareils projets dans leurs départements pour que les LGBT de régions ne soient pas laissé-e-s pour compte.
Une question reste posée sur le statut juridique d'une telle structure, et sur le rôle qu'y joueraient les associations, The Warning notamment (qui est vraiment le porteur du projet).
Il s'agit d'un projet pour les municipales à Paris mais pas exclusivement bien sûr.
Suicide chez les gays : bientôt des recherches officielles
Alors que toutes les études internationales pointent la sur-suicidalité des homosexuels –jeunes en particulier-, aucune étude française spécifique n'avait jamais été menée. Ce manque devrait être réparé dans les temps à venir.
Associations LGBT, spécialistes… cela fait des années que des militants et certains professionnels de santé travaillent sur le suicide des personnes LGBT et s'époumonent à demander le financement d'études sur cette question en France. Ce devrait être désormais acquis grâce à une mission confiée à l'Union Nationale de Prévention du Suicide (UNPS) par la très officielle Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère de la Santé (DREES).
"Cet organisme nous a confié plusieurs missions dont une consacrée au suicide et à l'orientation sexuelle, explique Pierre Sapet, vice-président de l'UNPS et fondateur de Suicide écoute en 1994. Nous souhaitons enfin être fixés sur la sur-suicidalité notamment des jeunes. Nous savons qu'elle existe en France mais elle n'est pas quantifiée. Notre travail a consisté à rencontrer professionnels et associations mobilisés [SOS Homophobie, Ligne Azur, Sida Info Service…] dans ce domaine et à faire des propositions sur ce qui pourrait être entrepris en terme d'études, de recherches. Jusqu'à présent, on se réfère beaucoup à des études conduites à l'étranger. Il est important que nous sachions quelle est la situation chez nous. Et ce d'autant que l'homophobie n'est pas un problème nouveau, que l'homosexualité reste encore un tabou dans notre société et que, dans notre pratique d'écoutant, la question de l'orientation sexuelle et des discriminations qui l'accompagnent est une constante même si ce n'est pas un fait majoritaire."
Remises à la DREES le 18 janvier, les recommandations devraient être suivies et donner lieu à la mise en place d'études sur le suicide (des jeunes et des moins jeunes) lié à l'orientation sexuelle, financées par les pouvoirs publics. E-llico Mis en ligne le 19/01/07
Enquête réalisée par Marc Shelly, médecin en santé publique à l'hôpital Fernand-Widal, à Paris et David Moreau, ingénieur de recherche à l'association de prévention Aremedia, travaux cités le 4 mars 2005 par le quotidien Libération, montrent que la probabilité qu'un homosexuel ou un bisexuel se suicide est 13 fois supérieure à celle qu'un hétéro le fasse.Dans la chaîne des responsabilités : chacun se défausse
Les suicides à cause de l'homophobie : environ 6000 par an ! sur un total d'environ 12 000
(dont 300 pour les seuls ados) et 25 000 tentatives
Ce matin un collégien a été retrouvé mort, il avait écrit sur un petit papier :
« je suis homosexuel et je sais bien que mes parents ne pourront pas le supporter ».Qui l'a tué et pourquoi est-il mort ?
Ces réponses fictives sont-elles loin de la réalité ? :
Les parents disent : « mais on ne lui a jamais parlé de ça ! On ne lui a jamais dit que c'était mal d'être homosexuel ! il n'est pas efféminé, il n'en a jamais parlé, on le présumait normal, on l'aurait adressé à un spécialiste afin qu'il guérisse, en fait il aurait fallu aborder le sujet, et lui dire que finalement s'il faisait tout pour changer, et aimer des femmes, par exemple en allant voir des prostituées, et qu'il n'y arrivait pas, on se ferait une raison ».
Les copains disent : « il était faible, souvent avec les filles, alors on lui a dit : pédé, tafiole, tantouze, tapette, mais c'était pour s'amuser, pour nous pédé ça veut dire faible comme un attaquant qui rate un but, nous on sait pas s'il était homosexuel, c'est les autres qui disaient ça, et puis c'était pour son bien, défends-toi ! reste pas avec les filles ! sois un homme ! fais le bon choix ! nous on n'aime pas les pédés, c'est ce qu'on dit partout, les pédés ça pue, les pédés c'est la honte, et partout on nous laisse le dire, c'est qu'on tient à notre réputation ». « J'ai vu ses agresseurs, ils le frappent dans la cour de récréation, ils se mettent à plusieurs, mais je suis pas une balance, je ne peux pas avoir un copain pédé ». "moi j'ai frappé, il le fallait, il faut que je montre que je suis un homme, un vrai, ce pédé nous fout la honte, quelle réputation on va avoir dans le quartier ?" "je me sens homosexuel, je suis celui qui a frappé le plus fort, parce que ce n'est pas normal d'être comme ça et moi je veux que ça passe !" " je ne vois pas où est le problème, jamais aucun prof d'école, aucun prof de collège aucun adulte éducateur ou pas ne nous a dit qu'il fallait pas taper une tapette, seraient-ils gênés par la question, seuls les gens normaux s'expriment sur ce sujet, moi je le revendique, c'est mon honneur"Les voisins : "il était gentil mais c'est la sélection naturelle, si on ne les élimine pas d'une manière ou d'une autre, après on va trouver les capotes partout, c'est dégoûtant, nous on a des enfants"
Les surveillants : « nous on ne nous laisse aucune initiative ici, on est les flics du collège, on n'a pas été formés, on est vu comme des gamins, pas des éducateurs si on intervient, on risque de nous le reprocher, et notre statut ne nous protège pas, on a bien vu les souffrances de ce gamin, mais il y a les autres, les agresseurs, on les signale mais ça ne sert à rien, ils sont protégés ».Le CPE dit : « je savais qu'il était l'objet d'insultes, les surveillants me l'ont rapporté, mais quel discours tenir ? on ne nous dit rien, à qui s'adresser ? à toutes les classes ? et si je suis seul à le dire, ne passerais-je pas moi-même pour homosexuel ? Vous savez, la cour de récréation c'est la cage aux fauves, je transmets les informations et j'attends la décision ».
Les profs disent : « Moi je n'en savais rien, il ne s'est jamais plaint » ; « moi j'ai entendu les moqueries, mais j'ai mon cours à faire et cette attitude est tellement générale, ils ne connaissent même pas le sens des mots qu'ils emploient, si je le défends je vais passer pour pédophile, ils confondent tout, et je n'ai pas été formé pour aborder cette question ». « Rien dans les instructions officielles ne nous dit qu'il faut traiter de la question et ce, quel que soient la matière ou les programmes, les manuels scolaires ignorent le sujet, c'est les inspecteurs et les recteurs qui doivent prendre leurs responsabilités ». « ça vient des parents, on ne peut suppléer les carences de la société » « aujourd'hui les jeunes homosexuels ont à leur disposition des sites internet, des associations, des lignes d'écoute, celui-ci devait être trop fragile psychologiquement ». "ce n'est pas mon affaire" "si je le fais seul, les élèves vont imaginer que je le suis ou pire : pédophile, je me mettrais en difficulté, en fait il faudrait travailler en équipe, toutes matières confondues et tous niveaux, il faudrait une commission, mais rien ne vient de la direction, peut-être y a-t-il une volonté politique de ne rien faire"
Le psy dit : « il n'est jamais venu me voir, c'est une affaire extrêmement délicate, on est dans l'ordre du privé, il faudrait s'adresser à toute la communauté scolaire ! Or beaucoup de parents ne souhaitent pas qu'on aborde des sujets aussi intimes en classe, il n'est même pas impossible de rencontrer un parent homophobe et qui n'accepte pas un tel discours, or l'homophobie lorsqu'elle pousse au crime est une pathologie ! ».
L'infirmière dit : « j'interviens tous les ans dans toutes les classes de 4 ème en binôme avec la conseillère conjugale et familiale et nous parlons de contraception, d'IST bref de la sexualité, et nous n'avons pas trop de 2 heures, alors parler des autres sexualités… On n'a reçu aucune instruction, on n'est pas formées en fait ».
"l'homosexualité est maintenant largement acceptée dans la société, ils savent qu'ils peuvent nous parler de tout". "Je n'ai reçu aucun message du Proviseur, aucune commission n'est chargée de traiter le problème, comme il est pourtant indiqué dans la circulaire".Le Proviseur dit : « La lutte contre toutes les discriminations est largement abordée dans beaucoup de cours, nous apprenons aux élèves la déclaration des droits de l'homme, nous luttons beaucoup contre le racisme et l'antisémitisme, car nous craignons les heurts entre communautés religieuses, mais ce sujet heurte les convictions religieuses de beaucoup de parents, l'école de la république qui est universelle est ouverte à tous, comme elle est ouverte aux homosexuels, pourquoi faudrait-il parler de cette communauté en particulier ? Personne dans la communauté scolaire n'a exprimé le désir qu'une commission soit nommée, pour étudier comment nous pourrions aborder le problème, or plusieurs questions se posent : quel cadre, quelles interventions, quels binômes,
quelle formation ? ». "Je n'ai reçu aucune consigne du Recteur".L'Inspecteur dit : "nous ne nous occupons pas des manuels scolaires qui est l'affaire du privé et donc des éditeurs, nous faisons les programmes de l'Enseignement Public, qui s'adressent à tous et toutes, sans nous occuper des particularités de telle ou telle communauté, il va de soi que chacun a le droit au respect et à la dignité, et nous ne voulons pas mettre certains professeurs en difficulté s'ils abordaient ce sujet délicat." Je n'ai reçu aucune consigne du Recteur.
Le Recteur dit : « les associations ont la possibilité de venir en classe bénévolement, expliquer ce qu'est l'homophobie, et d'ailleurs une académie a donné un agrément a une association, grâce à cela l'an dernier, 1200 élèves sur 12 millions soit un sur 10 000 ont pu être informé 2 heures dans tout leur cursus scolaire, et sans frais supplémentaire, vous ne pouvez dire qu'on ne fait rien ! or seuls 1,2 millions environ sont ou seront concernés, sans compter hélas ceux qui sont vus comme homosexuels sans l'être réellement. Il nous faut progresser dans l'égalité des chances y compris quelle que soit l'orientation sexuelle des élèves, et je donne toute ma confiance aux chefs d'établissements ». "Je n'ai reçu aucune directive de mon Ministre de tutelle".
Le Ministre de l'Education nationale : "il est tout à fait à l'honneur de mon prédécesseur d'avoir fait paraître une circulaire, dont je ne retire rien, et qui propose aux établissements d'intervenir 3 fois par an et par niveau pour parler des problèmes de santé, à eux de prendre leurs responsabilités, mais vous savez, des parents ont protesté quand ils ont vu que des associations homosexuelles pénétraient dans les établissements scolaires, et je ne dois pas choquer les opinions de la majorité de mes électeurs. Je dois tenir compte de l'avis des familles religieuses qui constituent une grande partie de mon électorat, davantage que de la laïcité. Les établissements ont tout à fait le droit de traiter de la question comme il est indiqué dans la circulaire, et je souhaite pour ma part que les enseignants se forment pour aborder ces sujets sans qu'il soit nécessaire d'organiser des stages, ce qui coûterait trop cher au contribuable."
Le Président de la République : je suis le seul Président à avoir dit à la télévision :" il faut lutter contre l'homophobie" Voyez-vous, lutter contre l'homophobie, c'est fondamental, cette seule phrase me sert d'action car j'ai bien autre chose à faire. Je laisse le ministre de l'éducation nationale que j'ai nommé, faire comme moi, d'ailleurs, il fait comme moi.
Son Eminence le Cardinal dit : "nous réprouvons le suicide, il n'aurait jamais dû commettre cette offense à Dieu, nous avons pour ce jeune une très grande compassion, et nous prions pour le salut de son âme, Dieu a rappelé à lui ce petit être qui allait commettre un pêché et c'est sans doute mieux comme ça, certes la religion est amour « aime ton prochain comme toi-même », mais les Ecritures… "
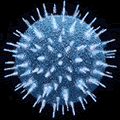
Interpellation des candidats à l'élection présidentielle de 2007 sur la vulnérabilité des hommes
A l'attention de Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, François Bayrou, Marie-Georges Buffet, Dominique Voynet, Olivier Besancenot, Arlette, Laguiller, Nicolas Dupont-Aignan, José Bové, Corinne Lepage, et copie à Nicolas Hulot.
Eric Verdier[1], le 11 février 2007
Mesdames, Messieurs,
En France, toutes tranches d'âge confondues, les hommes se suicident trois fois plus que les femmes. Concernant les deux autres causes de surmortalité non naturelles, à savoir les meurtres et les accidents, les
hommes sont également très largement surreprésentés du côté des victimes. Pourtant, à quelques exceptions près, aucune étude, aucun dispositif public, ne prend spécifiquement en compte la vulnérabilité des hommes en terme de violence et de santé.
Parallèlement, entre 25% et 50% des jeunes hommes qui se suicident sont concernés par l'homosexualité (cf extrait du rapport du ministère de la Santé joint). En terme de facteurs de causalité, et face à un déni
flagrant, l'homophobie sous toute ses formes – y compris intériorisée - devient ainsi la première cause de suicide chez les jeunes hommes de moins de 25 ans. Si vous pensez que l'Etat a un rôle à jouer pour
endiguer ce phénomène, je me permets de vous adressez les recommandations que j'ai faites et qui ont été intégrées au rapport 2006 de SOS Homophobie.
Suivant la même logique, lorsque des hommes plus âgés sont vulnérables, le taux inquiétant de violence contre soi – suicide, addictions, désinsertion sociale,… - et contre l'autre – maltraitance, violence
conjugale – rencontre les mêmes résistances. On ne reconnaît l'étendue des dégâts que si les hommes sont situés du côté de la déviance, et en aucun cas comme des victimes d'un système juridique et social inadapté à
ce qu'ils sont aujourd'hui. Le refus d'accorder la résidence alternée à un père qui en fait la demande lorsqu'il y a conflit parental – car la mère y est opposée – s'est généralisé dans les TGI depuis la loi de mars
2002. A l'image de ce père désespéré - Stéphane Lafargue qui s'est suicidé fin 2006, sans réaction de la classe politique - nombre de pères pensent que le déni de justice qui leur est opposé est une atteinte
grave aux droits de l'homme, celui de pouvoir élever ses propres enfants. Il est évident que les enfants en sont les premières victimes.
Vous trouverez ci-joint une plateforme de propositions urgentes de modification du code civil, afin de rétablir la coparentalité, et auxquelles ont répondu partiellement deux d'entre vous : Nicolas Dupont-Aignan et Ségolène Royal.
En écho, la visibilité médiatique de « l'homoparentalité » (terme stigmatisant par définition) contribue à ce que cela devienne un thème de campagne. Au vu des considérations précédentes, pas étonnant donc que
personne ne se penche sur la situation exacerbée des pères homosexuels, que ni le mariage ni l'adoption ne prend en compte – une femme homosexuelle a beaucoup plus de chance d'obtenir un agrément d'adoption
qu'un homme hétérosexuel. Sur ce point qui pourrait paraître marginal mais est donc au cœur du débat, vous trouverez ci-joint quelqueséléments de réflexion, extraits d'un article à paraître dans quelques jours pour la revue Pref Mag.
Quels sont donc les engagements fermes et opérationnels que vous prendrez si vous êtes élus pour répondre à l'urgence et à la gravité de la situation ? Je souhaite obtenir des engagements de votre part d'ici fin février, afin de pouvoir efficacement diffuser vos réponses – ou absence de réponse – dans les réseaux auprès desquels je bénéficie d'une écoute (à savoir les réseaux citoyens, militants et professionnels associés au suicide, à l'exclusion et aux discriminations, à la santé en général, à la parentalité et à la sexualité). J'insiste sur le fait qu'une absence de réponse est souvent ressentie par les personnes concernées beaucoup plus péjorativement qu'un désaccord sur la plupart des propositions.
Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez obtenir des précisions de ma part, ou me rencontrer.
Veuillez recevoir, Mesdames et Messieurs, l'expression de ma confiance citoyenne.
Eric Verdier - 06 16 81 78 73 – <mailto: verdiereric@wanadoo.fr > verdiereric@wanadoo.fr
[1] Eric Verdier est psychologue et psychothérapeute. Il a mené une recherche sur l'impact des phénomènes de discriminations et de bouc-émissaire chez les jeunes, à la Ligue des droits de l'Homme jusqu'en 2006 - notamment en terme de conduites suicidaires. Sur un soutien des ministères de la Santé et de la Justice , il poursuit en 2007 ses recherches à la Ligue Française pour la Santé Mentale , en généralisant à toutes les tranches d'âge, et plus particulièrement en direction des hommes, des pères et du masculin. Il a participé à
l'élaboration du plan de santé publique Violence et Santé. Il a coécrit deux ouvrages – « homosexualités et suicide » et « petit manuel de gayrilla à l'usage des jeunes » - et publie prochainement « Laissez moi tous mes parents, pour une reconnaissance de la coparentalité » auxéditions Hachette Littérature. Il est président de l'association Coparentalité et membre du Groupement d'Etudes et de Prévention du Suicide (GEPS). Il a participé ces dernières années à de nombreuses émissions de télé, de radio, ainsi que des articles de presse.Le suicide : L'homosexualité ne devrait pas être une raison pour se tuer!
Pourtant, les personnes homosexuelles présentent un risque élevé de suicide.
Bien que la perception à l'égard de l'homosexualité soit de plus en plus positive, il n'en demeure pas moins que les personnes qui la vivent sont toujours confrontées à des sentiments hostiles, allant de la moquerie au rejet pur et simple. Tous n'ont pas pour autant envie de se suicider. Par ailleurs, les études qui se sont intéressées à la question ont mis en évidence que les jeunes homosexuels présentent un risque de suicide beaucoup plus élevé que les jeunes hétérosexuels. Une recherche américaine menée par Bell et Weinberg en 1978 estime que les jeunes homosexuels sont, à l'âge de vingt ans, treize fois plus à risque de suicide que les jeunes hétérosexuels.
Une autre étude conduite en 1997 dans la région de Calgary (Bagley et Tremblay) montre que les jeunes gais et bisexuels sont quatorze fois plus à risque de suicide que les jeunes hommes d'orientation hétérosexuelle.
Cette réalité n'est pas étrangère à Gai Écoute. Même si le centre d'écoute téléphonique n'est pas spécialisé dans les questions du suicide, le spectre du suicide et surtout des idées suicidaires est présent dans de nombreuses interventions.
Si les morts pouvaient parler, plusieurs nous révéleraient une orientation sexuelle jusque-là insoupçonnée, même par les plus proches. Hélas, les enquêtes du coroner ne peuvent établir les mobiles secrets du suicide et qui ne sont même pas connus par les proches. Pour s'en faire une idée, il faut s'en remettre aux personnes qui ont fait des tentatives de suicide.
Il y a encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire pour convaincre les grands décideurs que les personnes homosexuelles constituent un groupe à risques de suicide. Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas pris l'orientation sexuelle en compte dans l'élaboration de sa stratégie d'action face au suicide publiée en 1998.
Dans ce contexte, depuis 1997, Gai Écoute travaille activement à faire évoluer ce dossier jusque-là ignoré au Québec. Bien que Gai Écoute ne soit pas un organisme de prévention du suicide, sa mission lui a toutefois permis de développer une sensibilité particulière à la problématique du suicide chez les personnes homosexuelles. Gai Écoute obtenait une subvention du ministère de la Santé et des Services sociaux en vue de mener une étude sur les mobiles de suicides chez les jeunes homosexuels.
Gai Écoute a donc joué un rôle de premier plan dans la reconnaissance de cette problématique en se faisant le promoteur de l'étude Mort ou fif dirigée par le professeur Michel Dorais de l'Université Laval, publiée en octobre 2000. L'Association québécoise de suicidologie soulignait d'ailleurs la contribution exceptionnelle de Gai Écoute à la prévention du suicide en lui décernant le Prix Réjean-Marier de l'année 2001.
La recherche a démontré les jeunes homosexuels québécois sont de six à quatorze fois plus à risque de suicide que les jeunes hétérosexuels, corroborant ainsi les études antérieures citées plus haut. Le professeur Dorais a mis en évidence que « les jeunes qui sont très tôt identifiés comme homosexuels subissent un harcèlement homophobe qui finit par saper leur goût de vivre. Ceux qui tardent à révéler leur homosexualité ou qui demeurent invisibles comme homosexuels vivent les même angoisses. Dans les écoles, le dénigrement et les agressions sont très souvent tolérés. Personne ne se porte à leur défense. »
Les témoignages recueillis auprès des jeunes qui ont participé à l'étude sont très révélateurs. « J'ai lâché l'école parce que je n'étais plus capable. Cette violence-là [vécue à l'école] me validait dans la haine de moi-même. J'avais 31 ans quand mes parents ont su de quelle violence j'étais victime au collège. Ça a été un choc pour eux… » Cette histoire personnelle n'est malheureusement pas un cas unique. L'étude nous révèle en effet qu'« il est consternant de constater le nombre de jeunes interviewés qui rapportent avoir été obligés d'abandonner leurs études au secondaire (ou du moins de changer d'école) simplement afin de fuir la haine et la violence qu'ils retrouvaient en milieu scolaire. »
Le Québec est déjà doté d'un réseau d'organismes en prévention du suicide dont la qualité du travail est reconnue. Gai Écoute cherche à mettre en place des services complémentaires et il ne saurait être question de développer des services parallèles.
Agir en première ligne signifie qu'il faut travailler sur l'adaptation à l'orientation sexuelle et non pas sur le suicide. Il faut intervenir avant la manifestation des désirs suicidaires. Beaucoup de personnes homosexuelles vivent dans la clandestinité, sont victimes de rejet et d'ostracisme. Elles ont le sentiment d'être seules. Lorsqu'elle communiquent avec Gai Écoute, avant même d'entreprendre la conversation, elles posent la question suivante : « Es-tu gai, es-tu lesbienne? » La réponse sera évidemment positive. Gai Écoute est le premier contact avec la communauté et la porte d'entrée vers les ressources disponibles.
Des programmes adaptés aux réalités homosexuelles doivent aussi être mis en place pour agir en première ligne. Être d'orientation homosexuelle et heureux dans la vie, voilà le message à répandre si l'on veut faire échec au suicide. 11 01 06 Fondation Emergence de MontréalDes lesbiennes deux fois plus dépressives que les hétéros
Les résultats d'une enquête réalisée par la faculté de sociologie de l'université de Gand, visant à dresser le portrait de la communauté homosexuelle en Flandre, montrent que les jeunes lesbiennes âgées de 16 à 26 ans souffrent deux fois plus de dépression que les jeunes hétéros du même âge. Les adolescentes lesbiennes auraient des difficultés à accepter leur identité et bénéficieraient de peu de soutien de leur environnement direct. Pour le professeur Johan Vincke, qui a mené cette enquête, ces résultats ne sont pas une surprise. «Des enquêtes précédentes montraient déjà que ce groupe comptait un fort taux de tentatives de suicide. Ces nouvelles données ne font donc que confirmer ce que nous savions déjà», affirme-t-il. La dépression est en revanche beaucoup moins présente parmi les plus de 26 ans, une fois que les jeunes femmes parviennent à assumer leur identité. L'enquête montre, en outre, que la moitié des gays flamands n'osent pas afficher clairement leur homosexualité. Un sur cinq déclare même la taire totalement. Têtu 24 05 06
Homophobie intériorisée : 20 % des hommes homosexuels déclarent "préférer ne pas être gay".
C'est le triste résultat d'une enquête interrogeant les homosexuels hommes sur leur santé et leur bien être. Dans le même temps, la très grande majorité d'entre eux pensent n'avoir aucun problème de santé, ne pas avoir besoin d'aller chez le médecin, parce qu'ils ne sont pas visiblement malades d'une manière générale.
Faut-il rappeler que la santé n'est pas seulement une absence de maladie mais un résultat multifactoriel faisant écho au bien être, à l'épanouissement, la réalisation de soi, l'estime de soi, la limitation des maladies et de leurs conséquences ...
Etre engagé dans une association ou militer pour une cause en rapport avec l'acceptation des homosexuels dans la société (se battre en faveur de sa communauté) est aussi très clairement identifié comme un facteur de protection et un déterminant favorable de notre santé. Alors qu'attendez-vous ?
par Valentina Viodorovna , 30 11 05 Site pederama
Note du collectif Antihomophobie : il est indécent que la formation des personnels de santé se fasse sans aucun module concernant l'homophobie et les diverses sexualités, le résultat est la persistance dans ce milieu d'une homophobie plus ou moins latente ou déclarée avec pour preuves, ces différents articlesDon du sang: ouverture aux homos malgré les réticences de l'EFS
Avec un retard de quelques mois sur la promesse faite, le ministère de la Santé est en train de faire cesser la discrimination empêchant les homosexuels de donner leur sang. Le nouveau questionnaire, dans lequel la question «Avez-vous eu des rapports homosexuels?» est remplacée par «Avez-vous eu des rapports sexuels à risque?», est terminé et sa diffusion devrait être effective dans tous les hôpitaux et autres centres de collecte de sang d'ici le mois de mai. Reste à définir la notion de «pratiques à risque» : cette réflexion est «en cours» , annonce-t-on au ministère de la Santé , où l'on se félicite «d'enclencher le moteur pour faire cesser une discrimination, tout en veillant à la nécessaire sécurité sanitaire, même s'il y a toujours des crispations» . Effectivement, sur Europe 1, mardi 13 février, le responsable médical de l'Établissement français du sang (EFS), le docteur Philippe De Micco, a réaffirmé son opposition au don du sang par les homos pour «des considérations de sécurité» . Sur France 3, le président de l'EFS, Jacques Hardy, a parlé de personnes «potentiellement dangereuses» en regard de la probabilité qu'un homosexuel soit séropositif, qui serait 60 fois supérieure à celle d'un hétérosexuel. Et de rappeler que la Halde s'était déclarée incompétente à statuer sur cette discrimination, le don du sang n'étant pas considéré comme un «service». Ces déclarations faisaient suite au dépôt de plainte contre X pour discrimination de Laurent Drelon, un Parisien de 36 ans. Il reproche à l'EFS de l'avoir listé comme homosexuel afin de lui interdire le don du sang, et ce, selon les fichiers de l'EFS, jusqu'au mois d'août… 2278. Têtu 16 02 07
Don de sang par les gays : le ministre de la Santé à nouveau interpellé
Alors que les médias français se font l'écho d'un début de pénurie de sang en France, la question de l'accès des homosexuels masculins au don de sang reste posée. L'association Centrégaux relance le débat et interpelle le ministre de la Santé.La France est l'un des pays occidentaux démocratiques où le don de sang reste interdit pour les homosexuels, et ce depuis une circulaire de 1983. L 'Etablissement Français du Sang a récemment rappelé dans un communiqué publié à Toulouse que "l'homosexualité masculine est un facteur d'exclusion conformément à la réglementation française décrétée dans les bonnes pratiques transfusionnelles". Cette discrimination s'applique que les donneurs potentiels aient eu ou non des conduites dites " à risque ".
Plusieurs associations LGBT, SOS homophobie, le CGL Paris et, ces derniers jours Centrégaux (les centristes gays) demandent la révision d'une situation qui date de plus de vingt ans. "Chaque année, indique SOS homophobie, de façon récurrente, nous recevons des appels ou des mails de gays, et parfois de lesbiennes, qui se sont vus refuser leur sang alors qu'ils voulaient en faire don par simple acte de générosité, le motif de ce refus : leur homosexualité".
La question de l'orientation sexuelle comme motif de refus du don du sang agite de plus en plus fortement les esprits.
Si cette mesure pouvait se justifier au regard des connaissances scientifiques de 1983, aujourd'hui 22 ans après, les statistiques démontrent que l'épidémie du sida en France se développe beaucoup plus rapidement chez les hétérosexuels que chez les gays. Il y a aujourd'hui en France plus d'hétérosexuels que de gays porteurs du VIH qui s'ignorent. Pourquoi, dans ces conditions, faire de l'homosexualité un critère de refus du don de sang ?
"Malgré toutes les précautions prises, seule l'honnêteté et la franchise des donneurs peut empêcher la transmission de sang contaminé, un homosexuel tout comme un hétérosexuel peut très bien mentir sur sa vie sexuelle lors du questionnaire mené par le médecin, explique SOS homophobie".
Dans les faits, toutes les précautions sont prises pour détecter d'éventuels dons de sangs contaminés aussi bien par le VIH que les hépatites par exemple. Chaque don est systématiquement testé individuellement. Chaque donneur est identifié par un numéro de don unique avec un code à barre qui est attribué à sa poche de sang pour assurer la traçabilité à chaque étape du circuit. Et lorsqu'une anomalie est décelée, le donneur est toujours prévenu aussitôt par l'EFS (Etablissement Français du Sang).
Le critère homosexuel dans le don sang est donc sans conteste une discrimination.
Une prise de position du ministre de la Santé Xavier Bertrand, en juillet dernier, qui s'était déclaré favorable à la levée de l'interdiction de principe du don du sang par les homosexuels n'a été suivie d'aucun effet. "Nous constatons donc toujours une différence de traitement entre un hétérosexuel ayant une conduite à risque (exclusion temporaire) et un homosexuel (exclusion définitive du seul fait de son orientation sexuelle)", déplore l'association Centrégaux qui parle de "discrimination honteuse" dans une nouvelle interpellation du Ministre de la Santé. "Il doit faire la différence entre l'orientation sexuelle et les conduites à risque, et signifier à l'Etablissement Français du Sang qui relève de sa compétence de revoir au plus tôt ses critères de sélection des donneurs, tel que l'a déjà fait l'Institut Portugais du Sang (IPS)". E-llico Mis en ligne le 13/02/07Communiqué de SOS- homophobie :
Vous vous demandez certainement pourquoi SOS homophobie ne réagit pas officiellement suite à l'annonce du Ministre de la santé. Voici l'explication : il y a un tel décalage entre ce qui s'est dit dans les réunions entre experts et associations par rapport à l'annonce de Xavier Bertrand que nous ne savons que penser.
Le "terrain" semble vouloir faire de l'obstruction systématique et le ministre veut imposer son projet.
Nous attendons donc de voir comment les choses vont se concrétiser. 13 07 06
M. Bertrand va ouvrir le don du sang à certains homosexuels, après vingt-trois ans d'exclusion
LE MONDE | 10.07.06 | 14h36 • Mis à jour le 10.07.06 | 14h45
Certains homosexuels masculins devraient, vingt-trois ans après leur exclusion, à nouveau pouvoir effectuer des dons du sang, contre l'avis de plusieurs experts de sécurité sanitaire.
"La contre-indication permanente actuelle visant "les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes" ne me semblait pas satisfaisante, car elle stigmatisait de facto une population et non des pratiques. Elle va donc disparaître" , a déclaré au Monde , le ministre de la santé, Xavier Bertrand.
Les responsables de l'Etablissement français du sang procèdent actuellement au renouvellement de tous les questionnaires auxquels sont soumis les donneurs de sang et, en liaison avec la Fédération française des donneurs de sang bénévole, un guide d'information et de prévention sur les pratiques sexuelles de ces donneurs est en cours d'élaboration.
M. Bertrand précise que les spécialistes ne lui ont pas apporté la démonstration que le don de sang d'un hétérosexuel ayant des rapports non protégés avec de multiples partenaires était moins dangereux que celui d'un homosexuel n'ayant aucune pratique à risque.
"Situation préoccupante"
"J'entends que l'on ne parle plus à l'avenir de "populations à risque" mais bien de "pratiques sexuelles à risque" , souligne M. Bertrand. Il ne s'agit pas pour autant d'ignorer une situation très préoccupante, celle de la recrudescence de l'épidémie de VIH parmi les homosexuels masculins ; il s'agit au contraire de rappeler le danger des pratiques à risque, qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles."
L'affaire avait été soulevée il y a peu par Jack Lang. Dans un courrier du 11 mai adressé à M. Bertrand, le député PS estimait que cette exclusion instaurée deux ans après l'émergence de l'épidémie de sida, constituait "une mesure discriminatoire extrêmement choquante" .
Dans sa réponse, datée du 17 mai, M. Bertrand expliquait que "l'homosexualité ne constitue bien évidemment pas en soi un critère d'exclusion (...) Les données épidémiologiques montrent que la prévalence de l'infection à VIH dans la population homosexuelle masculine sexuellement active serait de 12,3 %, contre 0,2 % dans la population générale. Ce n'est donc pas le fait d'être homosexuel, mais la pratique de relations sexuelles entre hommes qui constitue une contre-indication au don du sang. D'ailleurs, l'homosexualité féminine n'est pas une contre-indication." Jean-Yves Nau Article paru dans l'édition du 11.07.06Certains membres de EFS et INVH ont essayé d'éterniser la réunion, en effet, créer de la discrimination est plus facile que d'apprendre la tolérance, et ont tenu des propos hallucinants, tels que "même avec le préservatif le VIH des gays se transmet, pas celui des hétéros" quand on leur fait remarquer que l'Italie, l'Espagne et le Portugal autorisent le don du sang pour les gays, ils répondent " pour les latins la transmission du VIH est différente" voilà des "expertises" qui jettent le discrédit sur ces 2 institutions.
Ils n'avoueront jamais "on ne veut pas du sang des pédés" non ce n'est pas ça, c'est plutôt : "mais comment vont vivre ça les donneurs actuels ?"Interdire le don de sang aux gays est une décision homophobe, pour la ministre de la Santé Belge !
Mercredi 17 mai, lors d'une conférence de presse à la Maison Arc-en -ciel de Liège, la ministre de la Santé , de l'Action sociale et de l'Égalité des chances (PS) a qualifié l'interdiction faite aux homos de donner leur sang de « préjugé inacceptable». «Comment peut-on présumer que le sang d'un homosexuel est de moins bonne qualité que celui d'un hétéro?», a-t-elle déclaré. « C'est un acte homophobe ». Christiane Vienne a d'ailleurs promis d'essayer de « pousser le débat plus loin ». Pourtant, au Parti socialiste belge, tout le monde n'a pas l'air d'être sur la même longueur d'onde. Le même jour, Renaud Witmeur, chef de cabinet de Rudy Demotte, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique a déclaré au quotidien Le Soir : «Qui accepterait qu'on prenne le moindre risque de contamination? Il est inacceptable que l'on parle de discrimination .» Entre la Belgique et la France , ce sont donc deux positions bien différentes qui sont aujourd'hui défendues. Têtu 19 05 06un petit testing fait à l'initiative de france 3 mercredi après midi
en effet, l'ESF faisait un stand "don du sang" à quelques hectomètres du stand du CADOS sur la promenade des anglais
un jeune homme de 18-20 ans a accepté d'aller avec la caméra pour donner son sang. l'entretien avec le médecin s'est passé sans la caméra, mais avec le micro ouvert (sans que le médecin ne le sache). le médecin a bien sûr demandé à notre cobaye si il avait djà eu des relation sexueles avec un autre homme il a répondu que oui et le médecin l'a donc informé qu'elle ne pouvait pas prendre son sang même si elle ne trouvait pas ça normal. elle a ajouté qu'elle savait que la caméra attendait dehors, et lui a demandé de dire qu'il ne pouvait pas donner son sang à cause d'une angine... même pas le courage d'assumer l mauvaise presse éventuelle liée à leurs pratiques 19 05 06Le ministre de la Santé , Xavier Bertrand ne veut pas du sang des homos
Bertrand a souligné hier que « les relations entre hommes constituaient bien un facteur de risque, justifiant que les homosexuels masculins soient écartés du don du sang ». Dans une lettre au député socialiste Jack Lang, qui avait dénoncé "une mesure discriminatoire extrêmement choquante", le ministre explique que « ce n'est donc pas le fait d'être homosexuel, mais la pratique des relations homosexuelles entre hommes qui constitue une contre-indication au don du sang".Source : AFP Vendredi 19 mai 2006
Note du Collectif Anti-Homophobie : L'argument est bien sûr extrêmement discutable. Il n'enlève rien au caractère discriminatoire. Il est sous-entendu, entre autres que les pratiques homosexuelles (sans autre précision) sont plus risquées que les pratiques hétérosexuelles. Pourtant, sans être scientifique, il semble qu'une relation non protégée entre un homme séro+ et une femme séro- représente le même risque de contamination qu'une relation non protégée entre un homme séro+ et un homme séro-. Le ministre semble donc retenir implicitement l'idée que les comportements sexuels des homosexuels dans leur ensemble sont différents de ceux des hétérosexuels. Or, ça c'est bien de la discrimination.Don du sang: des homosexuels portent plainte contre l'EFS
L'association des gays, lesbiennes, bis et trans d'Andorre, Som com som («Nous sommes comme nous sommes» en catalan) a porté plainte en Andorre contre l'Établissement français du sang (EFS) de Toulouse, dont dépend l'Andorre en matière de transfusion, pour avoir interdit leurs dons, a-t-on appris hier, mercredi 11 mai, par les plaignants et le gouvernement. Cette affaire provoque depuis la fin avril un débat intense dans les médias et au Parlement, le Parti social-démocrate (PS) ayant demandé au gouvernement de rompre l'accord avec l'EFS au profit d'un établissement espagnol. « Une infraction est commise à l'encontre des donneurs homosexuels », s'est indigné Nicolas Pérez, président de Som com som. Cette association et un de ses membres, Marc Pons, conseiller municipal PS d'Andorre-la-Vieille, qui a voulu donner son sang, ont déposé deux plaintes fin avril contre le directeur de l'EFS. Marc Pons souligne qu'il « faut faire la différence entre les conduites à risque et l'orientation sexuelle ». L'EFS a rappelé dans un communiqué publié à Toulouse que « l'homosexualité masculine est un facteur d'exclusion conformément à la réglementation française décrétée dans les bonnes pratiques transfusionnelles» . En Europe, des pays comme la Suède appliquent la même restriction que la France. Mais le Portugal est revenu sur cette interdiction fin mars, du fait de l'existence de moyens techniques plus performants permettant de tester les dons . Et en France, les règles fixées par l'EFS depuis 1983 sont de plus en plus critiquées . Interrogé par l'AFP, le Premier ministre (parti libéral) Albert Pintat a indiqué qu'il avait « décidé quel que soit le prix politique de cette décision de maintenir l'accord avec l'EFS», la France disposant «des plus hauts niveaux de qualité et de sûreté ». Depuis cet accord de 1978, l 'Andorre a enregistré 20.546 dons du sang pour 70.000 habitants, transférés par la Croix rouge andorrane à l'EFS. (avec AFP) Têtu 11 05 06Jean-Luc Romero appelle le ministre de la Santé à permettre aux gays de donner leur sang
Suite à la délibération de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde) du 6 février dernier, qui s'est prononcée sur une évolution de l'interdiction systématique faite aux homosexuels de donner leur sang, Jean-Luc Romero, président d'ELCS, a interpellé le ministre de la Santé , Xavier Bertrand, pour qu'il mette fin à cette discrimination. Depuis une circulaire de 1983, l 'établissement français du sang (EFS) exclut en effet des populations du don du sang, utilisant le concept de «groupes à risque» et non pas celui de «conduites à risques». Ce qui conduit par exemple à exclure des personnes du fait de leur orientation sexuelle, quelles que soient leurs pratiques. Dans sa délibération, la Halde a pourtant jugé que «la décision d'exclusion définitive du don du sang d'une personne paraît devoir être prise sur la base des risques liés à son comportement ». Récemment la Suède et le Portugal ont mis fin à ces exclusions . Sos Homophobie, qui a lancé une pétition contre l'exclusion des homos du don du sang, invite d'ailleurs l'EFS «à suivre l'exemple du Portugal et à se baser sur les pratiques à risques et non sur des groupes à risques pour sélectionner les donneurs ». 02 04 06
SOS homophobie veut faire lever l'exclusion des homosexuels du don de sang
Face à la position - inchangée depuis une vingtaine d'années - de l'Etablissement Français du Sang qui exclut du don de sang les homosexuels, SOS homophobie lance une campagne pour collecter des promesses de don de personnes homosexuelles et réclame la révision de cette mesure.
"Chaque année, indique SOS homophobie, de façon récurrente, nous recevons des appels ou des mails de gays, et parfois de lesbiennes, qui se sont vus refuser leur sang alors qu'ils voulaient en faire don par simple acte de générosité, le motif de ce refus : leur homosexualité".
La question a presque disparu du débat public : l'orientation sexuelle peut-elle être, en tant que telle, un objet de refus du don du sang ?La réponse est oui. Depuis le 20 juin 1983, une circulaire relative à la prévention du sida par la transfusion sanguine a été mise en place par le Professeur Roux, Directeur Général de la Santé à l'époque, interdisant aux personnes homosexuelles ou bisexuelles de donner leur sang étant considérées comme un "groupe à risque", au même titre que les utilisateurs de drogues injectables, les personnes originaires d'Haïti et d'Afrique, entres autres. Si cette mesure pouvait se justifier au regard des connaissances scientifiques de l'époque et d'une population gay majoritairement touchée par le VIH, aujourd'hui 22 ans après, les statistiques démontrent que depuis 15 ans, l'épidémie du sida en France se développe beaucoup plus rapidement chez les hétérosexuels que chez les gays.
Il y a aujourd'hui en France plus d'hétérosexuels que de gays porteurs du VIH qui s'ignorent. Pourquoi, dans ces conditions, faire de l'homosexualité un critère de refus du don de sang ?
"Malgré toutes les précautions prises, seule l'honnêteté et la franchise des donneurs peut empêcher la transmission de sang contaminé, un homosexuel tout comme un hétérosexuel peut très bien mentir sur sa vie sexuelle lors du questionnaire mené par le médecin, explique SOS homophobie".
Dans les faits, toutes les précautions sont prises pour détecter d'éventuels dons de sangs contaminés aussi bien par le VIH que les hépatites par exemple. Chaque don est systématiquement testé individuellement. Chaque donneur est identifié par un numéro de don unique avec un code à barre qui est attribué à sa poche de sang pour assurer la traçabilité à chaque étape du circuit. Et lorsqu'une anomalie est décelée, le donneur est toujours prévenu aussitôt par l'EFS (Etablissement Français du Sang).
SOS homophobie considère donc que le critère homosexuel dans le don sang est une discrimination et s'insurge contre leur exclusion systématique. L'association a décidé de se mobiliser en lançant un appel national à tous les homosexuels masculins qui souhaitent donner leur sang et qui déclarent sur l'honneur ne pas avoir de conduites à risques lors de leurs rapports sexuels, ce qui sous-entend : pas de rapports non protégés, pas de partenaires multiples ou avec un partenaire unique depuis moins de 6 mois.
Ceux-ci pourront remplir une promesse de don du sang par internet :
Si vous souhaitez faire une promesse de don, cliquez ici.
"Cette campagne de don du sang a pour objectif de sensibiliser les Français(es) à cette discrimination trop souvent ignorée par les homosexuels eux-mêmes et davantage encore par tous ceux qui peuvent donner leur sang, insiste SOS homophobie. Nous voulons pointer du doigt l'amalgame sous-jacent à cette mesure qui associe les comportements à risque à une orientation sexuelle. Cette mesure ne sert qu'à stigmatiser une orientation sexuelle qui dérange et entraîne la ségrégation d'une minorité à un acte de citoyenneté et de solidarité, ce qui ne fait que renforcer l'homophobie ambiante".
Mis en ligne le 09/03/06 e-llicoVIH : l'Institut de Veille Sanitaire utilise la notion contestée de Groupes à risques
Sur le sommaire, publié en couverture, du numéro 13 de Prévalence, la revue de l'Institut de Veille Sanitaire, on peut lire ce titre annonçant un article : "vih-sida : les groupes à risque". Une expression depuis longtemps abandonnée du fait de sa dangereuse ambiguïté.L'expression de "groupes à risque" est combattue par les malades et les associations depuis le début de la pandémie. Ce terme prête le flanc à des interprétations stigmatisantes et discriminatoires, en laissant entendre que des groupes spécifiques seraient dangereux, puisqu'à risque. Il implique aussi que d'autres groupes de la population ne seraient pas concernés par le vih.
"Cette analyse a été faite et refaite, et nous la pensions partagée et validée par les épidémiologistes et l'IVS, explique Act Up. Pour défendre l'utilisation de cette expression, l'administration nous explique qu'elle est utilisée dans le cadre de toutes les pathologies infectieuses, sans connotation stigmatisante. Mais on ne peut parler avec les mêmes termes de toutes les pathologies : les modes de transmission du vih/sida, les discriminations que peuvent rencontrer les personnes les plus touchées par cette infection - migrantEs, homosexuels, ou usagers de drogues (même si la réduction des risques a fortement réduit la prévalence au sein de ce groupe) – font que l'expression "groupes à risques" prend un tout autre sens".
Contactée, l'IVS a proposé de modifier ce titre sur son site internet. Le journal papier continuera d'être diffusé, banalisant hélas cette expression.
"Même si l'intention de l'IVS n'est pas de stigmatiser les homosexuels ou les migrantEs, l'effet est malheureusement le même, déplore Act Up. Nous demandons à ses responsables de faire preuve de plus de vigilance. Cette administration assure un lien entre les spécialistes et le grand public. Elle se doit donc d'utiliser des termes, comme "groupes exposés" ou "vulnérables", qui ne sont pas susceptibles de véhiculer préjugés et discriminations. Et si nous parlons de risques alors il faut mettre en avant ceux posés par des pratiques, non par des groupes".
Mis en ligne le 27/10/05 e-llicoDon du sang : l'exclusion des gays fait polémique
Après SOS Homophobie, Jean-Luc Romero, président des Elus locaux Contre le Sida a demandé à l'Etablissement Français du Sang de "lever l'interdiction systématique et discriminatoire faite aux homosexuels de donner leur sang".
Le suicide
Les adolescents gays et les jeunes lesbiennes âgés de 15 à 25 ans se suicident 6 à 10 fois plus que les jeunes se sentant hétérosexuels. C'est ce que le professeur québécois Michel Dorais a indiqué à l'issue du colloque organisé sur ce sujet ce 17 juillet 2001 par l'Observatoire socio-épidémiologique du SIDA et des sexualités des Facultés Saint-Louis de Bruxelles.
À l'occasion de la 12e édition de la Semaine nationale de prévention du suicide du 10 au 16 février 2002 au Québec , l'association "Gai Écoute" (service d'écoute téléphonique et de renseignements) rappelle l'importance, pour les personnes vivant difficilement leur orientation homosexuelle, de parler de leur souffrance et de ne pas attendre d'être rendues à bout pour en parler.Selon une autre étude réalisée en Flandre , une jeune fille lesbienne ou bisexuelle sur quatre a tenté de se suicider au moins une fois alors que 12,4% des garçons homosexuels affirment être passés eux aussi à l'acte de désespoir. Chez les hétérosexuels par contre, ils ne sont respectivement "que" 5,4% et 5,9% à avoir été dans le cas.
Outre les données sur les tentatives déjà entreprises, il est frappant de constater que l'idée de suicide est particulièrement présente chez les homosexuels et les lesbiennes: 33,3% des garçons y ont pensé et chez les filles, cela monte à 45%, soit pratiquement une sur deux! Inversement, du côté hétérosexuel, ils ne sont 16,1% et elles ne sont que de 24,3% à avoir envisagé cette hypothèse pour surmonter leurs problèmes.
Les recherches menées en Amérique du Nord sont cependant plus avancées qu'en Europe. On remarque toutefois que le suicide est plus souvent commis par les garçons outre-Atlantique, et davantage par les filles en Europe.
L'étude qualitative de Michel Dorais indique que la première des deux (ou trois) tentatives est commise à 17 ans en moyenne, et que dans les deux-tiers des cas étudiés, il s'agit d'un empoisonnement. Les jeunes (âgés de 14 à 25 ans au moment des faits) proviennent surtout d'un milieu urbain. Pour la majorité d'entre eux, l'alcool et la drogue ont constitué des échappatoires, tandis que la relation avec le père est particulièrement problématique.
Pour Michel Dorais, si le taux de prévalence du suicide est à ce point important chez les jeunes gays et les jeunes lesbiennes, c'est en raison de l'intolérance affichée par autrui, bien plus que du choix de l'orientation sexuelle lui-même. Le Québécois rappelle qu'il y a quelques dizaines d'années encore, l'homosexualité constituait à la fois un péché, une maladie mentale et un crime. Un cas unique dans l'histoire, estime-t-il.
L'étude québécoise souligne en outre que, quelle que soit l'attitude de l'homosexuel (masquer, s'afficher, simuler l'hétérosexualité ou résister) face à la discrimination, l'homophobie conduit le gay dans une impasse. La situation n'a guère évolué ces 50 dernières années, estime Michel Dorais, pour qui les homosexuels sont le seul groupe de la population à ne pouvoir s'appuyer sur des proches ou sur les générations qui le précèdent quand ils sont victimes de discrimination. Vient ainsi s'ajouter à l'isolement la honte et la stigmatisation.
Le chercheur en conclut que l'école est prioritairement le lieu pour faire changer les mentalités . On y prodigue déjà un apprentissage de la tolérance, mais uniquement par rapport au sexisme et au racisme. L'orientation sexuelle n'y est pas encore évoquée.
Les intervenants du colloque ont également précisé que le suicide n'était pas la seule manifestation du vécu de l'homophobie, et il y avait d'autres symptômes - moins quantifiables -, comme la dépression ou la baisse de l'estime de soi.
Pour Michel Dorais, les jeunes gays d'Amérique du Nord meurent aujourd'hui davantage du suicide... que du SIDA.
(1) Professeur à l'université de Laval (Québec), Michel Dorais est l'auteur de l'étude" Mort ou fif - La face cachée du suicide chez les garçons". Cette étude constitue l'une des premières de ce type dans le monde francophone. A noter que le mot «fif» signifie «pédé» en français québécois.
(2) Etude réalisée en Flandre en 1998 par le sociologue John Vincke, Professeur à l'Université de Gand (RUG), auprès de 404 jeunes comportant autant d'homosexuels que d'hétérosexuels et
L'homosexualité n'est pas une raison pour se suicider
" L'homosexualité n'est pas une raison pour se suicider. Les personnes homosexuelles heureuses ont la responsabilité de donner l'espoir à celles qui éprouvent de la difficulté à accepter et à vivre leur homosexualité, ainsi qu'à leurs parents et à leurs proches. Elles doivent dire et montrer que les femmes et les hommes homosexuels sont aussi capables de grandes réussites et de bonheur dans la vie. Si elles ne le font pas, qui le fera? " - Laurent McCutcheon
Mort ou fif : résumé de l'étude québécoise
Cette étude aborde un double tabou: celui de l'homosexualité et celui du suicide chez les adolescents ou jeunes adultes. En dépit de recherches quantitatives assez concluantes menées au cours des dernières années, il y a encore réticence à reconnaître les liens possibles entre la stigmatisation sociale de l'homosexualité et le nombre élevé de tentatives de suicide chez les homosexuels ou identifiés comme tels. C'est pourquoi le but de cette étude qualitative, basée sur de nombreux récits de vie, fut de comprendre comment les conditions de vie réservées à ces jeunes pouvaient amener certains d'entre eux à tenter de mettre fin à leur existence.Après avoir fait le point sur la recherche nord-américaine portant sur le suicide chez les garçons homosexuels, quatre scénarios sont identifiés chez les jeunes interrogés: le parfait garçon, qui devient perfectionnisme et plus ou moins asexué pour se dédouaner de sa différence; le caméléon, dont personne ne soupçonne l'homosexualité secrète et qui se perçoit plus ou moins comme un imposteur; le fif de service, bouc émissaire des autres jeunes, en particulier à l'école, avec tous les problèmes d'estime de soi que cela provoque; enfin, le rebelle, en révolte ouverte contre le sort qui lui est fait à cause de son homosexualité.
Il ressort notamment de cette étude que c'est dans la famille et à l'école que se retrouvent les plus grandes difficultés à vivre l'homosexualité à l'adolescence. Dans les locaux scolaires et dans les cours (en particulier ceux d'éducation physique), le dénigrement, voire des agressions envers les jeunes identifiés comme homosexuels sont souvent tolérés. Personne ne confronte les propos et les actes homophobes. Dans la famille, le dévoilement de l'homosexualité représente souvent une crise qui fragilise d'autant plus les jeunes gais ou bisexuels qu'ils n'ont alors plus personne vers qui se tourner, l'école et la famille étant leur principaux milieux de vie.
Les jeunes homosexuels suicidaires ne voient plus aucune perspective d'avenir devant eux. La non reconnaissance sociale de leur existence et de leur réalité, voire le rejet et les violences qu'ils subissent, contribuent grandement à provoquer leurs tendances puis leurs tentatives suicidaires. Le suicide chez les jeunes homosexuels ou bisexuels est la conséquence directe et prévisible de l'absence de place qu'ils ont dans la société.
Tout, ou presque, concoure à leur passer le même message: on aimerait mieux qu'ils n'existent pas. Certains d'entre eux ne comprennent que trop bien ce message. C'est pourquoi cette étude est un appel à une meilleure prévention du suicide chez les jeunes homosexuels ou bisexuels, prévention qui passe par plus d'information et de sensibilisation auprès des jeunes et des adultes qu'ils côtoient (parents, professeurs, aides éducateurs, etc.). Des perspectives de sensibilisation sur le vécu de ces jeunes et des pistes de prévention du suicide sont donc proposées pour contrer leur désarroi d'une part et l'indifférence, l'incompréhension ou l'intolérance auxquelles ils font face d'autre part.
Jean-Luc Romero interpelle Philippe Douste-Blazy (UNITAID) et Ban Ki-moon (ONU)
Election de Philippe Douste-Blazy à la présidence d'UNITAID et de Ban Ki-moon en qualité de secrétaire général de l'ONU.
Jean-Luc Romero, président d'ELCS, les appelle à condamner, dans les plus brefs délais, les restrictions discriminatoires à la liberté de circulation des personnes séropositives.
communiqué de presse Jean-Luc Romero - 10 octobre 2006
J ean-Luc Romero, président d'Elus Locaux Contre le Sida, se réjouit de l'élection de Philippe Douste-Blazy, ministre des affaires étrangères, en tant que président d'UNITAID. Cette élection vient consacrer le rôle moteur tenu par la France dans l'instauration de la contribution internationale de solidarité sur les billets d'avion et la création d'UNITAID. Elle est également une reconnaissance de l'engagement global de la France dans la lutte contre le sida. Parallèlement, Ban Ki-moon, actuel ministre des affaires étrangères de Corée du Sud a été élu, par le Conseil de sécurité, secrétaire général de l'ONU.
Alors que leurs mandats respectifs commencent ou débutent dans les prochaines semaines, Jean-Luc Romero, président d'ELCS, les appelle à faire de la libre circulation des personnes séropositives une priorité.
En effet, dans plus de la moitié des états membres de l'ONU, des mesures discriminatoires à l'encontre de la liberté de circulation des personnes séropositives sont appliquées.
Plus surprenant, en Corée du Sud, pays dont Ban Ki-moon est actuellement ministre des affaires étrangères, les artistes étrangers professionnels (danseurs célibataires, chanteurs célibataires, musiciens célibataires !!!) qui séjournent en Corée pour plus de 3 mois sont obligés à présenter un certificat de test négatif sous peine d'expulsion du pays. Jean-Luc Romero estime que l'existence de barrières liées au statut sérologique VIH des voyageurs est injustifiée et intolérable : en effet, comment accepter que plus de 40 millions de personnes soient privées de leur droit élémentaire de libre circulation du seul fait de leur état de santé ? Comment accepter que les séropositifs ne puissent légalement travailler au siège des Nations Unies alors que l'ONU a pour mission de promouvoir le respect des droits de l'homme au niveau mondial et que son action se fonde sur le principe de non-discrimination ? Le fait d'être séropositif ne peut être considéré en soi comme une menace. A partir du moment où la lutte contre le sida est correctement prise en charge par le gouvernement national, aucune raison ne justifie d'opposer ce type de restriction à une personne séropositive. FGL 11 10 06
Saint Valentin : première fête des amoureux pour les séropositifs et ceux qui les aiment
Le Comité des familles pour survivre au sida organise, ce mardi, la première "fête des amoureux" pour "les séropositifs et ceux qui les aiment", faisant partager sa "conviction que le VIH ne tue pas l'amour".
Les organisateurs convient adultes et enfants, le soir de la Saint-Valentin , à faire la fête dans le 19ème arrondissement de Paris.
"Nombreux sont les séropos pour qui le diagnostic signifie abstinence, solitude et isolement, écrit l'association dans un communiqué. Pourtant, depuis le début de l'épidémie, des hommes et des femmes contaminés ont montré que l'amour est plus fort que le virus : nous avons appris à aimer, à faire l'amour, à élever nos enfants, à nous occuper de nos familles, malgré l'injustice de la maladie"."C'est pour répondre à ce besoin humain de rencontrer, d'aimer, de partager que le Comité organise la première fête des amoureux pour réunir des célibataires et des couples, mais aussi tous ceux qui partagent notre conviction que le VIH ne tue pas l'amour", conclut-il.
Mis en ligne le 14/02/06 e-llicoUn séropositif sur 3 est rejeté par sa famille
Je n'oublierai jamais le jour de mon procès, quand je suis passé aux aveux, il y a eu un long silence gêné dans l'assemblée, pour la première fois j'ai senti à quel point ça pouvait faire mal d'être jugé. On m'a accusé de tout, on m'a traité de pervers, on m'a demandé de ne plus jamais m'approcher de ma famille, mais le plus insupportable dans tout ça, c'est que ceux qui me jugeaient c'est ma propre famille à qui je venais simplement d'avouer ma séropositivité un dimanche de janvier à l'heure du goûter. Stop à l'exclusion AIDES
Que faire avec les séropositifs contaminants ? Un dossier d'e-llico
Gays : peu de plaintes, de rares condamnations
Pourquoi les gays ne portent-ils pas plainte ? "C'est lié à l'histoire de la communauté gay, explique Emmanuel Château, co-président d'Act Up-Paris. Le pédé qui irait se plaindre d'avoir été contaminé, on lui dirait "T'avais qu'à mettre une capote !" Et puis, il y a le multipartenariat, la culpabilisation intégrée [ce qui m'arrive est de ma faute] et la difficulté à apporter la preuve de sa contamination par une personne précise." "La majorité des gays qui se contaminent se sentent responsables, voire coupables de ne pas avoir utilisé de préservatifs avec leur partenaire, également parce que, d'une manière générale, les gays ont peur de porter plainte et de dévoiler ainsi leur pratiques sexuelles à la police, à la justice, et en conséquence, aux médias et au grand public" note, pour sa part, Michael Hauserman, coordinateur du projet Santé gaie de l'association Dialogai en Suisse.
> A ce jour, il n'y a eu aucune condamnation en France concernant les gays. Ailleurs, les condamnations sont rares, mais elles existent. Ainsi en juillet 2003, un jeune séropositif gay suédois est condamné à quatre ans de prison ferme pour relations sexuelles non protégées alors que ses partenaires n'ont pas été contaminés. La même année, un gay séropositif est condamné à trois ans de prison en Suisse. Aux Etats-Unis, les condamnations de gays sont nombreuses. Il y a aussi eu des condamnations concernant des homos en 2001, 2003 et 2004 en Grande-Bretagne. En revanche, toujours en Grande-Bretagne, un gay accusé d'avoir transmis le VIH à son partenaire a été acquitté en août 2006. Il faut noter que la plupart de ces affaires concernent des gays ayant une connaissance de leur statut sérologique mais l'ayant caché. C'est ce qui fait dire aux associations de lutte contre le sida que la pénalisation pousserait davantage les gays à ne pas vouloir connaître leur statut sérologique qu'à passer le test.France : la crainte des politiques
La pénalisation de la transmission par voie sexuelle n'est pas à l'ordre du jour à l'Assemblée Nationale ni au Sénat (1) Pas davantage au ministère de la Santé , même si des experts évoquent de temps à autre le sujet. Il n'en reste pas moins que les associations craignent encore le vote d'une loi spécifique. "Le verdict de Strasbourg [réaffirmé à Colmar, voir p. X] a changé la donne. Il existe maintenant une faille quant à la pénalisation de la transmission du VIH. Ce verdict crée une nouvelle norme, avance Georges Sidéris de Warning. C'est cette constatation qui nous avait fait poser la question d'un texte législatif, non pas pour pénaliser la transmission du VIH mais au contraire pour l'empêcher. Notre démarche à l'époque n'avait pas été comprise, les associations pensaient que nous étions pour la pénalisation, alors que nous cherchions au contraire un moyen de sortir de la pénalisation. Mais depuis nous avons pu expliquer notre propos. Il y a eu aussi de nouvelles arrestations, confirmant nos analyses et nos craintes sur la brèche ouverte dans le dispositif législatif."
(1) Le Sénat a tenté en 1991 lors de la réforme du Code pénal de sanctionner pénalement "toute personne consciente et avertie qui aurait provoqué la dissémination d'une maladie transmissible épidémique par un comportement imprudent ou négligent". L'Assemblée Nationale a annulé cette disposition.Sanction : ce qui se fait à l'étranger
Des pays comme le Danemark, la Suède ont érigé la transmission du VIH en infraction spécifique. C'est aussi le cas dans la moitié des Etats américains. Dans des pays comme l'Autriche, la Suisse (une trentaine de condamnation depuis 1992), ce sont les dispositions du code pénal relatives aux "lésions corporelles" qui s'appliquent. Dans de nombreux pays (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Bas, Canada…) la transmission du VIH par voie sexuelle est le plus fréquemment considérée comme une voie de fait (grave préjudice corporel, empoisonnement, transmission de maladie contagieuse…). Au Canada comme en Suède, la loi oblige les séropositifs à annoncer leur statut avant toutes relations sexuelles. C'est en Suède et en Finlande qu'on dénombre le plus fort taux de personnes condamnées par rapport à la population globale vivant avec le VIH. Enfin, à défaut d'être exhaustif, signalons que certains pays ne sanctionnent pas seulement la transmission effective mais également "le fait d'exposer l'autre à un risque de transmission". C'est le cas en Norvège, en Suède comme en Russie.
Pour en savoir plus, on peut notamment se reporter à l'étude de législation comparée du Sénat. Infos sur www.senat.frPénalisation : l'avis du Conseil National du Sida
Suite aux procédures judiciaires (closes ou en cours) portant sur la transmission sexuelle du VIH, le Conseil National du Sida (CNS) a émis le 27 avril 2006 un avis. Reprenant les nombreux éléments du débat, le CNS indique que "Dans certains cas de transmission, la responsabilité pénale d'une personne transmettant le VIH semble clairement engagée, ainsi que la jugé la Cour de cassation (voir encart Ce qui se fait en France). Pour autant, il serait catastrophique que ces cas individuels conduisent à considérer que le seul fait de vivre avec le VIH fasse de la personne un criminel potentiel et renforce une stigmatisation existante. En dehors du domaine pénal, le CNS affirme le principe d'une double responsabilité ; responsabilité des personnes contaminées de ne pas transmettre le VIH et responsabilité de toute personne de se protéger pour ne pas être contaminée." De ce fait, le CNS recommande, notamment, d'inciter "tous les acteurs de la lutte contre le VIH à diffuser ce principe de double responsabilité dans les actions de terrain qui s'y prêtent" et de "développer les capacités de dire et de négocier les moyens de prévention des personnes vivant avec le VIH."
Il est possible de consulter l'intégralité de l'avis du CNS sur cette question sur www.cns.sante.frWarning : «Eviter le spectre du séropo contaminateur»
L'association Warning a particulièrement travaillé sur la question de la pénalisation de la transmission par voie sexuelle. Georges Sidéris, son porte parole, resitue les enjeux pour les gays.Pour quelles raisons, selon vous, les gays ne sont quasiment pas concernés aujourd'hui par les plaintes visant à sanctionner la transmission du VIH ?
Il y a un élément culturel. La culture de prévention, héritée des années 80-90 fondée sur la notion de responsabilité partagée, fait que l'idée que l'on est individuellement responsable de sa situation et donc éventuellement de sa contamination demeure vivace chez les gays — même si cette idée est de plus en plus remise en question actuellement. De plus, il faudrait qu'il y ait possibilité par la partie plaignante de prouver un élément manifeste de tromperie pour qu'il y ait possibilité d'un procès. En outre, la situation de multipartenariat chez les gays rend l'accusation de contamination par une personne donnée plus difficile.
Est-ce que la question de la pénalisation de la transmission du VIH peut "prendre" chez les gays français ?
Oui et non. Non à cause de ce qui vient d'être dit. Oui parce que malheureusement dans le milieu du militantisme sida certaines attitudes l'encouragent. C'est la manière réductrice avec laquelle sont envisagées les relations sexuelles sans préservatif qui pose problème. Elle ne fait pas de distinction et assimile les gays à des irresponsables, voire des contaminateurs. Elle ne peut qu'encourager la pénalisation de la transmission du VIH.
Comment expliquez-vous que ce débat ait peu mobilisé les associations de lutte contre le sida ?
Le sujet est très difficile, complexe, soulève les passions, génère des propos d'une violence extrême et du coup les associations ont peur de s'impliquer. C'est pourquoi — en gros — elles laissent le débat se dérouler entre Aides, Act Up, Warning, Didier Lestrade et Femmes Positives [association de femmes contaminées par leurs partenaires dont certaines ont porté plainte en justice]. Je crois aussi qu'elles sont déroutées, désemparées. Le débat sur la pénalisation oblige à poser la question de la pertinence ou de la non pertinence actuelle des conceptions de la prévention telle qu'elles ont été pensées dans les années 80 et 90. Bien des associations voient parfaitement que les paradigmes traditionnels de la prévention ne sont plus acceptés par tous les gays et que les discours incantatoires ne fonctionnent pas. Mais les débattre les place face à un tel abîme qu'elles préfèrent s'y accrocher.
Lors d'une de vos interventions (septembre 2005), vous disiez "Du point de vue de la prévention, l'idéologie de la responsabilité partagée est aujourd'hui obsolète". En quoi ?
Cette idéologie supposait que chacun était responsable de sa protection. Comme les dernières décisions de justice désignent un coupable, cette idée ne fonctionne plus. La prévention fondée sur cette idéologie s'appuie également sur le présupposé que le partenaire sexuel est potentiellement séropositif. Ce présupposé pouvait fonctionner à l'époque de l'hécatombe, mais aujourd'hui beaucoup de gays ne partagent pas ce présupposé et c'est pourquoi j'ai dit que cette idéologie, qui était globalisante, était obsolète. Nous touchons là à une question complexe, mais qui est un élément fondamental de la réflexion à Warning. L'évolution du mode de vie des gays, l'évolution globale de la société française avec l'acceptation du PaCS, du couple homo, la reconnaissance de l'homosexualité comme une sexualité spécifique légitime, l'exigence d'égalité de la part des LGBT avec les personnes hétérosexuelles ont des conséquences majeures. Par exemple, comme pour le couple hétéro, de plus en plus de gays estiment que le couple gay doit être fondé sur la confiance. Pour deux gays séroconcordants l'abandon du préservatif est de plus en plus une étape essentielle dans la construction du couple. Il est donc important dans une perspective de prévention, de prendre en compte ces réalités afin d'adopter des messages adaptés.
Quels effets auraient, sur les séropositifs, une pénalisation renforcée de la transmission du VIH ?
Les personnes séropositives subiraient une augmentation des attitudes discriminatoires à leur encontre car c'est le spectre fantasmatique du contaminateur qui serait agité dans la société. Elles vivraient dans une insécurité en cas de rapport avec un partenaire séronégatif car elles vivraient dans le système social du soupçon permanent. On peut penser que beaucoup de personnes séropositives craindront alors d'avoir des rapports sexuels avec des personnes séronégatives.
Comment se pose aujourd'hui la question de la pénalisation de la transmission du VIH chez les gays alors que de nouvelles approches de la prévention sont désormais connues ?
Je pense que la question principale actuellement pour les gays n'est pas la pénalisation mais la norme. Le développement des discours du soupçon à l'encontre des personnes séropositives et le ton de plus en plus agressif des campagnes de prévention favorisent le développement du sérochoix. Certains séronegs pensent qu'ils sont en sécurité s'ils n'ont des rapports qu'avec des séronegs et certains séropos pensent que des rapports avec des séropos uniquement, c'est des problèmes en moins. Surtout il y a la question des traitements. Si les personnes sous traitement sont peu susceptibles de transmettre le VIH alors la question de la pénalisation va se poser de façon sensiblement différente. La mise au point de microbicides efficaces changerait aussi fondamentalement la donne.
Site de Warning : www.thewarning.infoDialogai : «Il y a un plan éthique et un plan pénal»
Coordinateur du projet Santé gaie de l'association Dialogai en Suisse, Michael Hausermann a travaillé sur la question de la pénalisation de la transmission du VIH. Une pénalisation que la Suisse applique depuis les débuts de l'épidémie de sida. Il revient pour "Illico" sur les effets de cette politique, notamment chez les gays.La Suisse pénalise la transmission du VIH. Quels sont les résultats de cette politique ?
Il n'y a pas de loi spécifique sur la pénalisation de la transmission du VIH en Suisse. Les juges se basent principalement sur un article du Code pénal (art 231) qui date du milieu du 20ème siècle visant la santé publique : "propagation d'une maladie de l'homme dangereuse" et selon les cas, sur d'autres articles du Code pénal visant la protection des individus (lésions corporelles simples, graves et par négligence). Le but premier de l'article 231 était de lutter contre la transmission de la syphilis et d'autres infections sexuellement transmissibles, en particulier dans le milieu de la prostitution. Cet article était tombé en désuétude grâce à la découverte de traitements efficaces contre les IST. Cet article a été, à nouveau, utilisé pour condamner la transmission du VIH surtout à partir du début des années 1990 dans certains cantons suisses où la justice était aux mains de procureurs conservateurs. Dès le début, les organisations suisses de lutte contre le sida se sont opposées à cette pratique jugeant qu'elle était contraire aux principes de la campagne STOP SIDA : responsabilité individuelle, solidarité et absence de stigmatisation, et qu'elle pouvait créer un sentiment de fausse sécurité dans la population.
Quels effets cette politique a-t-elle eu sur les séropositifs ?
Difficile de répondre exactement à cette question car aucune étude n'existe sur ce point. En termes de prévention, cette politique n'a vraisemblablement aucun effet dissuasif car l'épidémie du VIH n'est pas moins importante en Suisse que dans les autres pays occidentaux qui ne pénalisent pas. Par contre, le risque d'être dénoncé ou condamné a certainement un effet négatif sur la possibilité de dire sa séropositivité en public et incite à la dissimulation. Sur le plan psychologique, cette situation est malsaine car de nombreux séropositifs souffrent du double sentiment de victime et de coupable. Coupable de n'avoir pas mis de préservatif, victime de l'infection, coupable de ne pas en mettre toujours, etc. Et se taire sur ses sentiments ne permet pas ou ralentit le processus d'acceptation.
Pensez-vous que "Du point de vue de la prévention, l'idéologie de la responsabilité partagée est aujourd'hui obsolète" ?
Le concept de la responsabilité partagée n'est pas traité de la même manière sur le plan éthique et sur le plan pénal. Sur le plan éthique, l'idée de responsabilité partagée est une bonne philosophie si les deux partenaires partagent plus que la baise. On ne peut pas parler de responsabilité partagée lorsque l'on tire un coup avec un partenaire anonyme. Dans ce dernier cas, pour être efficace en terme de prévention, il vaut mieux dire clairement aux séronégatifs qu'ils sont seuls responsables de leur santé et de leur protection. Dans la réalité, on ne peut pas prendre la responsabilité pour quelqu'un d'autre (concrètement cela veut dire qu'un séropositif ne peut pas prendre ou enlever la responsabilité du port du préservatif à un séronégatif). En revanche, si une relation régulière s'établit entre deux partenaires, il est raisonnable d'attendre que les partenaires s'informent mutuellement de leur état de santé. Le droit pénal ne connaît pas le concept de responsabilité partagée. L'auteur d'un crime peut avoir des circonstances atténuantes et voir sa peine réduite mais la victime n'est jamais condamnée pour avoir été coresponsable de la faute. Il y a un coupable et une victime. La loi suisse actuelle conduit à des situations totalement absurdes : le partenaire séropositif d'un couple sérodifférent peut être condamné pour avoir transmis le VIH à son partenaire, même si ce dernier était consentant et récemment une personne a été condamnée alors qu'elle n'avait même pas contaminé son partenaire.
Comment se pose aujourd'hui cette question de la pénalisation chez les gays en Suisse alors que de nouvelles approches de la prévention sont désormais connues ?
J'imagine que vous voulez parler du fait qu'une personne séropositive sous traitement régulier et avirémique [dont la charge virale est trop basse pour être détectée ] ne peut pas contaminer ses partenaires. Cette connaissance médicale récente n'a pas encore d'effet sur l'application du droit pénal et devra d'abord être digérée par les acteurs de la prévention. Toutefois c'est un argument qui pourra être utilisé pour essayer de faire changer la loi en Suisse.
Pour plus d'infos, on peut consulter ces deux sites : www.dialogai.org
www.santegaie.ch
Des lesbiennes deux fois plus dépressives que les hétéros
Les résultats d'une enquête réalisée par la faculté de sociologie de l'université de Gand, visant à dresser le portrait de la communauté homosexuelle en Flandre, montrent que les jeunes lesbiennes âgées de 16 à 26 ans souffrent deux fois plus de dépression que les jeunes hétéros du même âge. Les adolescentes lesbiennes auraient des difficultés à accepter leur identité et bénéficieraient de peu de soutien de leur environnement direct. Pour le professeur Johan Vincke, qui a mené cette enquête, ces résultats ne sont pas une surprise. «Des enquêtes précédentes montraient déjà que ce groupe comptait un fort taux de tentatives de suicide. Ces nouvelles données ne font donc que confirmer ce que nous savions déjà», affirme-t-il. La dépression est en revanche beaucoup moins présente parmi les plus de 26 ans, une fois que les jeunes femmes parviennent à assumer leur identité. L'enquête montre, en outre, que la moitié des gays flamands n'osent pas afficher clairement leur homosexualité. Un sur cinq déclare même la taire totalement. Têtu 24 05 06
Les séropositifs : des délinquants ?
Les Onzièmes Etats généraux d'ECLS se tiendront le 25 novembre 2006 au Sénat
« Les séropositifs : des délinquants ? »
Les personnes séropositives ne seraient plus considérées comme des malades mais comme des menaces à l'ordre public ou même pire, comme des délinquants ?
De nombreux signaux pourraient le laisser penser : restrictions discriminatoires à la liberté de circulation des séropositifs dans la moitié des pays de l'ONU, remise en cause de la politique de réduction des risques, débat sur le classement du Subutex en tant que stupéfiant, hausse des discriminations à l'encontre des personnes touchées par le VIH/sida, débat sur la pénalisation de la transmission du VIH...
L'association Elus Locaux Contre le Sida, présidée par Jean-Luc Romero, premier élu au monde à avoir révélé sa séropositivité, lutte contre cette logique qui laisserait à penser que la séropositivité pourrait être vue autrement que sous l'angle de la santé et de la solidarité publique.
Placés sous le Haut patronage du président de la République , les 11èmes Etats généraux d'ELCS permettront de rappeler avec force que les séropositifs ne sont ni des menaces à l'ordre public ni des délinquants mais des citoyens vivant avec un virus.
A quelques jours de la Journée mondiale de lutte contre le sida, cette édition permettra d'aborder les thèmes qui font débat : la réduction des risques, les discriminations, la lutte contre le sida à l'international... Ce colloque rassemblera des personnalités du monde politique - des personnalités du monde du spectacle -
Durant ce colloque se déroulera également une exposition de tableaux, représentant des personnalités dans « la peau » d'un personnage historique de leur choix. Les bénéfices liés à la vente de ces tableaux qui aura lieu du 23 novembre au 1er décembre sur e-bay seront intégralement reversées à l'association Dessine-moi un mouton, association qui aide et accompagne les enfants, les adolescents et les familles touchés par le VIH/Sida.
Communiqué de presse des Elus Locaux Contre le Sida, 9 novembre 2006Des nouvelles mesures de sécurité dans les avions engagent la liberté de circulation des séropositifs
ELCS attire l'attention sur les conséquences de la mise en place des nouvelles mesures de sécurité dans les avions pour la liberté de circulation des séropositifs et appelle à une évolution urgente de la législation des Etats-Unis.
Le ministre de la santé, Xavier Bertrand, sollicité ce matin par Jean-Luc Romero, président d'ELCS, s'est montré attentif à ce problème.
Depuis hier, date de la mise en place de mesures de sûreté européennes dans les avions, les liquides de plus de 100 millilitres sont interdits en cabine sauf exception, notamment les médicaments. Ceux-ci doivent être présentés avec le certificat médical pour être acceptés en cabine.
Ces mesures sont justifiées par des objectifs de sûreté et sécurité publiques et, bien évidemment, ELCS ne remet pas en cause leur utilité. Mais, au-delà des quelques désagréments dus au retard à l'embarquement, ce genre de mesures, également mises en place aux Etats-Unis, a des conséquences directes sur la liberté de circulation des personnes séropositives dans le monde - plus de 40 millions de personnes -.
En effet, il faut rappeler qu'aux Etats-Unis, 1ère puissance mondiale, l'entrée des personnes séropositives est tout simplement interdite : la personne qui se verra reconnaître comme séropositive sera expulsée du seul fait de son état de santé. Faudrait-il rappeler que le sida est une maladie transmissible mais pas contagieuse ? Le fait de contrôler les médicaments permettra à coup sûr aux agents douaniers d'identifier les séropositifs, comme s'ils étaient des menaces à l'ordre public ou des délinquants !
En pratique, une personne séropositive ne pourra échapper aux contrôles car elle ne pourra se permettre de mettre ses médicaments en soute : un retard ou une perte de bagages n'est pas à exclure et l'observance des traitements est obligatoire pour une maladie qui reste mortelle. En outre, la délivrance d'anti-rétroviraux ne peut se faire facilement en pharmacie comme un simple médicament.
Ces mesures de sécurité, certes contraignantes mais nécessaires, ne font que démontrer le caractère intolérable et injustifié de l'interdiction opposée aux personnes touchées par le VIH/sida d'entrer aux Etats-Unis.
En conséquence, Elus Locaux Contre le Sida demande que la législation des Etats-Unis évolue de façon urgente. Lors d'un rendez-vous qui a eu lieu ce matin même, Jean-Luc Romero, président d'ELCS, a sollicité Xavier Bertrand, ministre de la santé, sur ce dossier. Le ministre de la santé s'est montré attentif à ce problème. FGL 10 11 06Une nouvelle assurance sur Prêt pour personnes à risque aggravé Le SNEG salue et observe le lancement de Solidaris,
Depuis de nombreuses années, pour ainsi dire dès sa création en 1990, le SNEG s'est intéressé à la question de l'assurabilité des séropositifs. Un sujet devenu plus crucial encore à partir de 1995 et dans les années qui suivirent, avec l'apparition des trithérapies. En effet, plus de dix ans après ce tournant décisif en terme de traitements, les trithérapies ont fait la preuve de leur efficacité et les séropositifs peuvent s'inscrire dans des perspectives d'avenir, bâtir des projets, comme tout un chacun, leur pathologie ne présentant pas de risque supérieur à celle de n'importe quelle autre maladie chronique.
Pour autant, dans le secteur de l'assurance, maillon indispensable au montage d'un emprunt pour l'acquisition d'un bien personnel ou professionnel, ce changement considérable n'a pas été pris en compte. Aujourd'hui encore, combien de séropositifs doivent renoncer à emprunter, quand leurs dossiers d'assurance sont systématiquement rejetés ou bien surprimés dans des proportions telles que l'opération devient financièrement inconcevable, dès lors qu'ils déclarent leur affection ? En conséquence, pour l'obtention de leur crédit, combien de séropositifs sont contraints à mentir en remplissant sur l'honneur des questionnaires médicaux, acquittant les versements d'une prime d'assurance qui en cas d'accident, de problème médical ou de décès, n'assurera pas la moindre prise en charge ? Malgré la convention Belorgey, aujourd'hui remplacée par la toute nouvelle convention Aeras (Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé), dans la pratique, l'assurabilité demeure encore à ce jour un véritable parcours du combattant quand ce n'est pas une mission impossible pour les séropositifs.
Au nombre des multiples interpellations qu'il a lancées, le SNEG s'est rapproché de 3A Assurances-Cabinet Autran, courtier en assurances adhérent du syndicat, s'étant déjà illustré par la mise en place de produits adaptés aux besoins de la clientèle gay et lesbienne. Pendant plusieurs années, au fil d'un long cheminement, le SNEG a informé et orienté Frédéric Autran sur ce sujet, multipliant avec lui les réunions et les rencontres, prenant en compte les besoins et obligations tant de l'emprunteur que des autres intervenants : établissement financier, assureur, réassureur...
Depuis quelques jours, une solution est concrètement proposée : Solidaris. Réunissant l'intégralité des professionnels intervenant dans la contraction d'un crédit, celle-ci propose les garanties nécessaires à toute personne de moins de 60 ans empruntant jusqu'à 750 000 € sur 20 ans. Solidaris affiche une volonté d'ouverture à tous, sans discrimination, concrétisée par une étude personnalisée au cas par cas, pour un emprunteur asymptomatique ou non à l'affection à VIH.
Pour avoir toujours été indigné du traitement inéquitable réservé aux personnes séropositives, accompagné le cabinet 3A Assurances depuis l'information relative à cette situation jusqu'à la naissance de ce produit, le SNEG ne peut que saluer la mise en place de Solidaris. Toutefois, face à un produit à vocation commerciale même légitime, il se propose d'observer avec la plus grande vigilance l'application effective de ce produit dans les mois qui viennent pour, au terme d'un premier bilan, juger de trouver en lui une des solutions tant attendues au problème de l'assurabilité des personnes séropositives. Communiqué du SNEG, Mardi 31 octobre 2006 FGLVers moins de discrimination à l'emprunt pour les malades?
Xavier Bertrand et Thierry Breton, respectivement ministre de la Santé et des Solidarités et ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, ont signé hier, jeudi 6 juillet, une convention qui doit permettre aux malades, du sida notamment, de pouvoir avoir accès au crédit plus facilement. La discrimination à l'emprunt et au crédit est dénoncée depuis longtemps par les associations de malades. Cette nouvelle convention, dite Aeras (s'Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé), remplacera à partir du 1er janvier 2007 la convention Belorgey, signée en 2001. Les associations Aides et Sida Info Service se sont félicitées des avancées de ce nouveau document, tout en reconnaissant qu' «on est encore loin du compte» pour faire disparaître toutes les discriminations à l'accès au crédit. Parmi les changements annoncés, un meilleur respect de la confidentialité des dossiers et une obligation pour les banques et les assureurs de motiver leur refus par écrit. En outre, le montant des crédits immobiliers autorisé sera plafonné à 300 000 euros. Pour les crédits à la consommation, le montant du prêt accordé sans questionnaire de santé est augmenté de 50%, soit 15.000 euros maximum. Autre nouveauté: le «risque invalidité». Avec la convention Belorgey, seul le risque décès était pris en compte. Désormais si une personne se retrouve dans l'incapacité de travailler, l'assurance pourra, dans certains cas, participer au remboursement du prêt. Pas assez satisfaisant, a malgré tout jugé l'association UFC-Que choisir, qui a préféré ne pas signer la convention Aeras, craignant que son application soit finalement aussi défavorable aux malades que l'était l'application de la convention Belorgey. L'association des paralysés de France (APF), tout en reconnaissant des améliorations, lui a emboîté le pas. Selon le ministre de la Santé et des Solidarités, quelque 9.000 malades ont vu leur dossier d'emprunt refusé l'année passée.
Lire le texte de la Convention Aeras (pdf) Têtu 07 07 06Accès des malades aux assurances : nouvelle convention signée mardi
La nouvelle convention destinée à garantir l'accès au crédit et à l'assurance des personnes présentant des risques de santé aggravés -dont le sida- sera signée mardi, ont annoncé les ministères des Finances et de la Santé dans un communiqué commun.
La signature officielle de cette convention dite "Aeras" (Assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé), sera organisée mardi à 10h30 au ministère de la Santé , précise le communiqué. La convention "Aeras" a été paraphée vendredi par les ministres des Finances et de la Santé , Thierry Breton et Xavier Bertrand, avec les acteurs concernés. Les discussions, lancées le 23 mai, ont réuni les associations de malades, les associations de consommateurs, ainsi que les fédérations professionnelles des secteurs de la banque et de l'assurance.
Le but est d'améliorer la convention Belorgey signée en 2001, censée encadrer l'accès à l'assurance et aux prêts à la consommation, professionnel et immobilier, des personnes malades (cancer, maladies cardio-vasculaires, séropositivité et sida, etc.). Mais la convention Belorgey n'avait pas empêché des pratiques discriminatoires à l'égard des malades, auxquels était refusé l'accès à des prêts. La nouvelle convention doit entrer en vigueur à "la fin de l'année ou au début de l'année prochaine", a précisé le ministère des Finances.
Mis en ligne le 26/06/06 e-llicoSida et séropositifs : lancement d'une campagne contre les discriminations
Le ministère de la santé et l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (Inpes) ont lancé jeudi une campagne contre les discriminations envers les personnes séropositives qui débute dimanche.La campagne, comportant notamment des spots TV et radio du 11 au 25 juin, et des actions sur le Net, vise à favoriser une meilleure acceptation sociale des personnes, ce qui a des implications directes en matière de prévention, a souligné Philippe Lamoureux, directeur général de l'Inpes.
L'accumulation des rejets et discriminations peut entraîner ceux qui en sont victimes à avoir des comportements à risques, a-t-il remarqué.
Selon une enquête auprès de séropositifs contactant la ligne Sida Info Service, plus de 8 sur 10 déclarent avoir subi au moins un événement discriminatoire dans leur vie sociale ou privée. Certains dentistes refusent encore de les soigner, par exemple.
La campagne, d'un coût estimé à plus de 2 millions d'euros selon le ministre, cible le grand public et des populations les plus exposées (homosexuels, migrants notamment Africains et habitants des Antilles et de la Guyane ).
Concernant la lutte contre les discriminations, Xavier Bertrand a notamment évoqué les démarches, auprès des banquiers et assureurs avec lesquels une réunion est prévue le 23 juin, pour aboutir à une "nouvelle version de la convention Belorgey" afin de permettre un réel accès au crédit (consommation etc) aux gens touchés par le virus.
Outre les sites d'information ou à visée préventive ( www.havefun.fr et www.e-vonne.com ), sera ouvert courant juin un site avec des conseils pour couples envisageant l'arrêt du préservatif ( www.tienstoispret.fr ). Mis en ligne le 09/06/06 e-llico